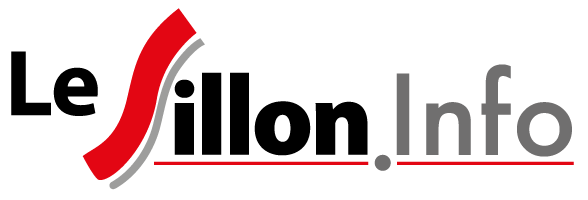Influenza aviaire : près de 350 millions d’euros de pertes
La date du 29 mai a marqué la fin du vide sanitaire de six semaines imposé dans les zones du Sud-Ouest touchées par l’épizootie d’influenza aviaire H5N8. Toutefois, le redémarrage est lent en raison, essentiellement, du manque de canetons. L’heure est donc au bilan des pertes engendrées par cette nouvelle crise sanitaire.

Au total, le plan d’abattages préventifs décidé par les services du ministère de l’Agriculture a concerné près de 4,5 millions de canards, dont 1,9 million d’animaux dans les exploitations touchées par le virus. À ces chiffres, il faut ajouter les nombreux canards qui n’ont pas pu être mis en production durant l’épizootie et le vide sanitaire. Le Cifog estime cette perte induite à 7,5 millions de têtes. Ainsi, ce sont donc près de 12 millions de canards perdus pour la production française de foie gras, ce qui va à nouveau mécaniquement faire baisser la production française.
Tous les maillons de la filière foie gras ont subi les conséquences de l’épizootie d’influenza aviaire et de son plan d’éradication : les couvoirs, les producteurs et les entreprises de transformation. Par ailleurs, l’épizootie et le plan d’éradication ont également eu d’importantes conséquences collatérales sur la fabrication d’aliments, le transport des animaux, le transport de denrées, les ressources pour les organisations de production, les prestataires de services…
Premier décompte
Fin mai, le Cifog estimait les pertes financières pour l’ensemble des maillons de la filière (accouvage, élevage, transformation) à plus de 350 millions d’euros. Les pertes évaluées se répartissent, à 50 millions d’euros pour l’accouvage, 31,4 millions pour le dépeuplement, 86 millions pour les pertes de production à l’amont et 180 millions d’euros pour l’aval.
À ces chiffres, s’y ajouteront les pertes consécutives à un lent redémarrage de l’activité. En effet, les couvoirs du Sud-Ouest, tous sinistrés dans de plus ou moins grandes proportions, ne pourront retrouver leur pleine capacité de production qu’au printemps 2018. Et ceux situés dans les zones indemnes, en Poitou-Charentes ou dans les Pays-de-la-Loire, ne peuvent pas totalement satisfaire la hausse brutale de la demande.